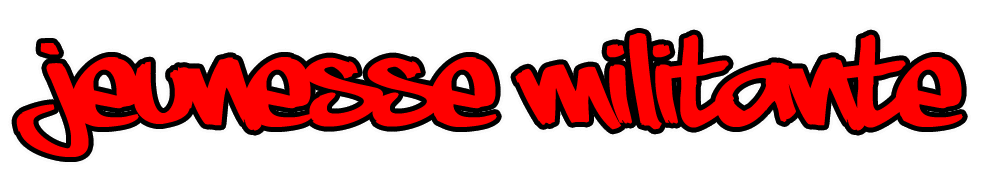Que les « sauveurs » étaient en fait les coupables. Trois heures avant l’éboulement, les mineurs de San José avaient demandé à pouvoir sortir, suite à des bruits suspects. Le refus de leurs supérieurs les a emprisonnés sous des tonnes de terre. Surprenant ? Non, le 30 juillet, un rapport du ministère du Travail signalait d’importants problèmes de sécurité à la mine de San José. Sans suite, le ministre étant resté muet.
Que les « sauveurs » étaient en fait les coupables. Trois heures avant l’éboulement, les mineurs de San José avaient demandé à pouvoir sortir, suite à des bruits suspects. Le refus de leurs supérieurs les a emprisonnés sous des tonnes de terre. Surprenant ? Non, le 30 juillet, un rapport du ministère du Travail signalait d’importants problèmes de sécurité à la mine de San José. Sans suite, le ministre étant resté muet.
Tout le monde s’est évidemment réjoui du happy end. Mais le show du sauvetage a occulté l’ampleur du problème : quatre cents mineurs chiliens sont morts ces dix dernières années. Et surtout les causes : « Faiblesses des investissements et des normes de sécurité », a indiqué Marco Enriquez-Ominami, l’adversaire de Sebastián Piñera aux dernières élections présidentielles. En effet, pour la seule année 2009, le Chili a enregistré 191.000 accidents de travail qui ont tué 443 travailleurs. Et c’est l’Etat chilien qui en est directement responsable, car depuis douze ans, il a refusé de ratifier la Convention 176 de l’Organisation Internationale du Travail sur la sécurité et la santé dans les mines. Les entreprises ont toutes les libertés, les travailleurs aucun droit.
Derrière le sauveur, se cache le milliardaire
Il était sur tous les écrans, en permanence : chef d’Etat souriant, concentré, soucieux de ses citoyens. Un peu trop lisse, cette image d’Epinal ? Qui est réellement Sebastián Piñera, élu président en 2009 avec 51,61% des suffrages ?
A 61 ans, il possède 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait la 701ème fortune mondiale selon la revue Forbes. Cette fortune, il l’a bâtie grâce aux mesures prises par la sanglante dictature militaire de Pinochet (1973-1990). Le Chili de cette époque incarnait le laboratoire du néolibéralisme impulsé par ces économistes extrémistes qu’on avait surnommé les Chicago Boys. De ces privatisations, Piñera a su profiter en faisant main basse sur le secteur des cartes de crédit.
Surnommé « le Silvio Berlusconi latino-américain », Piñera possède actuellement Chilevision, une des grandes chaînes télé du pays, et Colo Colo, une des principales équipes de football. Il est également actif dans la distribution, l’industrie minière et pharmaceutique. En accédant au poste de président, il a été obligé de vendre ses parts de la compagnie aérienne Lan Chile (il était l’actionnaire majoritaire). Double casquette donc : chef d’Etat et puissant homme d’affaires. Interpellé sur cette confusion des rôles par le journal argentin Clarín, il a répondu : « Seuls les morts et les saints n’ont pas de conflits d’intérêts ».
Un saint, Piñera ne l’est certes pas. Monica Madariaga, ministre de la Justice pendant la dictature militaire, a reconnu avoir fait pression sur des juges, à l’époque où Piñera était gérant d’une banque. La fraude se serait élevée à près de 240 millions de dollars. En 2007, Piñera a aussi été condamné pour délit d’initié par l’autorité des marchés financiers suite à l’achat des actions de Lan Chile. Comme disait le grand écrivain français Honoré de Balzac, « derrière chaque grande fortune se cache un crime ». Celle de Piñera a la couleur du sang des victimes de la dictature.
En cachant son passé, en le présentant comme un ami du peuple, le show télévisuel sur la mine de San José a fourni à Piñera une véritable opportunité politique. Avec son casque jaune, il a grimpé dans les sondages. La droite chilienne, qui n’osait plus se montrer après la dictature, a pu redorer son blason.

Piñera, la victoire posthume de Pinochet et des USA
Malgré ces scandales, Sebastián Piñera sait se valoriser. Sa campagne électorale a mis en avant son « amour pour la démocratie » et son vote contre le maintien de Pinochet au pouvoir lors du plébiscite de 1988. Il est ainsi parvenu à se faire élire sur base de son image de « l’homme qui a tout réussi ». Comme si faire fortune impliquait une bonne gestion de l’Etat. Au contraire : sa fortune s’est justement construite en affaiblissant la collectivité.
Et il s’apprête à continuer. Cet admirateur de Nicolas Sarkozy entend privatiser les propriétés de l’Etat, sous prétexte de couvrir les pertes provoquées par le grand tremblement de terre de février 2010. Il s’agirait de vendre au privé 40% de Codelco (n° 1 du cuivre) ainsi qu’une autre entreprise minière Cimm T&S. Cela prend tout son sens quand on sait que le Chili est le premier exportateur mondial de cuivre. Il faut savoir que certaines multinationales des Etats-Unis ont commis les pires crimes pour conserver le contrôle de ces richesses.
En 1970, un gouvernement progressiste, dirigé par Salvador Allende, avait entrepris de développer le Chili et de sortir sa population de la pauvreté. Pour ce faire, le pays devait récupérer le contrôle de sa principale richesse : le cuivre. En obtenir un prix plus correct et affecter ces revenus aux besoins pressants de la population. Aussitôt, les Etats-Unis se sont déchaînés : blocus financier, déstabilisation par la CIA, actions terroristes, chantages en tous genres... Jusqu’au coup d’Etat militaire et à l’instauration de la dictature fasciste d’Augusto Pinochet. Des milliers de victimes, toute une génération progressiste massacrée ou exilée.
Dans son discours à l’ONU, en décembre 1972, soit quelques mois avant son assassinat, le président Allende décrit le pillage de son pays par les multinationales US du cuivre, Anaconda Company et Kennecott Copper Corporation : « Les mêmes firmes qui ont exploité le cuivre chilien durant de nombreuses années ont réalisé plus de quatre milliards de dollars de bénéfices au cours des quarante-deux dernières années, alors que leurs investissements initiaux avaient été inférieurs à trente millions de dollars. Un exemple simple et pénible, un contraste flagrant : dans mon pays, il y a six cent mille enfants qui ne pourront jamais profiter de la vie dans des conditions humaines normales parce que durant les huit premiers mois de leur existence, ils ont été privés de la quantité indispensable de protéines. Mon pays, le Chili, aurait été totalement transformé avec ces quatre milliards de dollars. Une infime partie de ce montant suffirait à assurer une fois pour toutes des protéines à tous les enfants de mon pays. » La victoire électorale de Piñera, c’est au fond la victoire posthume de la dictature, le retour au pouvoir des Etats-Unis.
D’ailleurs, Piñera compte aussi emprunter à la Banque Interaméricaine de Développement, dominée par les USA. Cet emprunt imposera de nouvelles mesures d’économies antisociales. Cette offensive générale du privé contre le public n’a rien d’étonnant dès lors qu’un milliardaire a carrément pris la présidence de l’Etat. Toute apparence d’indépendance entre les deux sphères s’évanouit : le ministre des affaires étrangères dirigeait la chaîne de grands magasins Falabella ; celui de la Santé dirigeait la clinique privée Las Condes, la plus chère du pays. Même s’ils ont temporairement abandonné ces postes, ils prennent des décisions qui les concernent de façon très intéressée.
Avec de tels milliardaires au pouvoir, pas étonnant que les entreprises soient taxées de façon ridicule : 3% en 2011 et 1,5% en 2012 ! Sous prétexte, toujours, du tremblement de terre. En fait, le Chili occupe la 21ème place mondiale des Etats taxant le moins le Capital. Et la première place en Amérique latine (source : Pricewaterhouse Coopers). Sur ces liens entre la dictature et Piñera, sur ces projets antisociaux, les télés n’ont rien dit.
Occultée : la colère des mineurs
Dans ce pays où le chef d’entreprise est roi, Piñera a quand même dû constituer une commission sur la sécurité au travail après le drame de San José. Elle rendra ses conclusions le 22 novembre. Il a aussi créé un organe de contrôle des mines, et décidé de revoir le règlement de sécurité minière.
Ce n’est pas le cadeau d’un milliardaire au grand cœur, c’est juste un recul face au mécontentement. Juste après le sauvetage des mineurs, leurs collègues ont manifesté pour réclamer leurs salaires et leurs primes non perçues, la formation continue des jeunes travailleurs, la validation des acquis, la retraite des aînés et les indemnités de licenciement. Le 7 septembre, d’ailleurs, les syndicats chiliens ont exigé la ratification de la convention sur la sécurité et la santé dans les mines, mais aussi dans le bâtiment et dans l’agriculture.
Mais ce que la télé n’a pas dit, c’est que ces violations des droits des travailleurs trouvent leurs origines dans les réformes opérées sous la dictature. Les années Pinochet ont transformé la santé, l’éducation et la Sécurité sociale en simples marchandises. Les emplois ont été précarisés et flexibilisés. Et ces réformes néolibérales sont restées quasiment intactes, car elles n’ont jamais été remises en question par les gouvernements de la Concertation (alliance des démocrates-chrétiens et socialistes), qui se sont succédés pendant vingt ans depuis Pinochet. Bafouer les droits des travailleurs - et même les droits de l’Homme - est toujours légal au Chili.
Sur ce terrain aussi, Piñera est impliqué. C’est son frère José qui était ministre du Travail dans les années 80, sous la dictature. C’est lui qui a appliqué le néolibéralisme pur et dur des Chicago Boys, en imposant que les retraites soient « capitalisées », c’est-à-dire en fait privatisées. Ce désastre nous ramène au Camp Esperanza. Un des 33, Mario Gomez, a commencé à travailler dans les mines à douze ans. Aujourd’hui, à soixante-trois ans, il y est toujours ! Pourquoi ? Parce que sa retraite est dérisoire. Merci, José Pinera ! De tout cela, la télé n’en a rien dit.
Un des pays les plus injustes au monde
« Miracle économique » aux yeux de Washington, le Chili figure en réalité parmi les pays les plus injustes au monde. Les statistiques du CASEN (centre d’enquête sur la situation socio-économique nationale) montrent que la pauvreté grimpe au même rythme que le PIB (production globale du pays). Celui-ci augmente, mais ne profite qu’à une partie de la population, creusant davantage les inégalités. La pauvreté a augmenté de 15 % en 2009. Particulièrement touchés : les enfants de moins de trois ans. Un sur quatre est pauvre selon le CASEN.
Mais ces chiffres officiels sous-estiment encore la réalité, car ils se basent sur un calcul datant de 1988, qui considère qu’un pauvre est une personne gagnant moins de 2.000 pesos par jour. Or, un ticket de bus revient à 500 pesos ! Il n’a donc pas été tenu compte de l’augmentation du coût de la vie. Une estimation plus réaliste aboutit à huit millions de pauvres, soit la moitié de la population. Face à cela, la section des droits de l’Homme de l’ONU reste muette. Et les Etats-Unis, grands défenseurs de la démocratie, considèrent le pays comme un allié et même un exemple. Est-ce un hasard si le Chili se rapproche aujourd’hui de la Colombie, considérée comme l’agent des Etats-Unis en Amérique latine ?
Au final, la société chilienne a été divisée, déchue de ces droits, mal informée et réduite à la soumission par des médias uniformes. L’objectif de la droite se situe dans la continuité du régime militaire, et même de la Concertation. Le pays devient de plus en plus un paradis pour les entreprises, réprimant travailleurs et syndicats. Sebastián Piñera garantit la préservation du modèle de la Constitution que Pinochet avait imposée en 1980. Il risque même de l’approfondir. La télé n’en a rien dit.
A quoi sert un show ?
Résumons (et tirons-en les leçons, car de pareils shows, on nous en resservira encore). Pendant des jours et des jours, les grands média internationaux nous ont ressassé le même conte de fées : un milliardaire au grand cœur, tellement soucieux des pauvres ! Pendant des jours et des jours, cette télé unique a laissé de côté les méfaits et les plans égoïstes de ce milliardaire, ses liens avec la pire dictature, sa servilité envers les Etats-Unis.
Toutes les caméras, chiliennes et internationales, ont été braquées sur ce show. Rien sur, par exemple, l’impressionnante grève de la faim des indigènes Mapuche. Durement réprimés, traités comme des terroristes, leur lutte a été étouffée. Par contre, la télévision nous a tout raconté sur les mineurs, jusqu’à leurs secrets les plus intimes. On a découvert la double vie de certains, des enfants cachés et des maîtresses. On se serait cru en pleine téléréalité. Zéro info, que de l’émotion à la louche : les maisons de production annoncent un film, un téléfilm et un livre. Quelle opportunité pour s’en mettre plein les poches ! Pour assurer les détails poignants, le journal de bord d’un des rescapés est au cœur de toutes les convoitises. On estime que les acheteurs potentiels seraient prêts à débourser jusqu’à cinquante mille dollars. Ces 33 histoires seront donc exploitées au maximum, mettant à nu la vie privée de 33 personnes.
Le principe du « show » télévisuel, c’est d’empêcher la réflexion. Pour cela, on joue sur l’émotion avec des techniques bien étudiées qui scotchent le spectateur et gonflent les recettes publicitaires. Cette émotion est systématiquement exploitée afin de cacher l’absence de toute véritable enquête sur les causes des problèmes. Par exemple, un accident de travail est presque toujours le résultat d’un conflit entre des intérêts opposés : le profit contre la sécurité.
Aucune enquête donc sur les responsabilités des « sauveurs » et de l’Etat chilien. Pas d’enquête sur nos gouvernements occidentaux qui ont été complices de Pinochet et ont refusé que ce criminel soit jugé. Pas d’enquête sur les questions actuelles fondamentales… Pourquoi un Latino-Américain sur deux est-il pauvre alors que ce continent regorge de richesses et que les multinationales y font d’énormes profits ? Pourquoi nos gouvernements occidentaux s’opposent-ils à tous ceux qui tentent de combattre la pauvreté ? Pourquoi ces gouvernements n’ont-ils rien fait lorsque la CIA a tenté des coups d’Etat pour éliminer Hugo Chavez, Evo Morales et Rafael Correa ? Pourquoi ne font-ils rien contre le coup d’Etat militaire qui a réussi au Honduras ? On y tue systématiquement des journalistes, des syndicalistes des militants des droits de l’Homme et cela ne provoque aucune campagne médiatique internationale ?
A la place de ces véritables enquêtes, la télé nous bourre le crâne avec les messages du genre « milliardaires et travailleurs, tous dans le même bateau »… Pour vraiment s’informer, il faudra chercher ailleurs.
Source : michelcollon.info